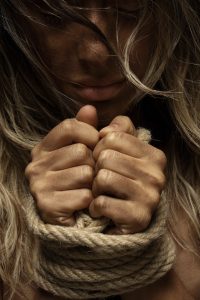Les compétences des jeunes au service de la paix et du développement
En 2014, l’Assemblée générale des Nations Unies a déclaré le 15 juillet Journée mondiale des compétences des jeunes, afin de célébrer l’importance stratégique de doter les jeunes de compétences pour l’emploi, le travail décent et l’esprit d’entreprise.
Le thème de la Journée mondiale des compétences des jeunes de 2024, « Les compétences des jeunes au service de la paix et du développement », souligne le rôle crucial que jouent les jeunes dans la consolidation de la paix et la résolution des conflits.
Le monde est aujourd’hui confronté à une multitude de défis, dont beaucoup touchent les jeunes. Les conflits qui perturbent l’éducation et la stabilité, un environnement numérique polarisé qui entraîne des attitudes négatives, et des inégalités économiques persistantes limitent dans l’ensemble les opportunités offertes aux jeunes. Ces problèmes menacent non seulement leur avenir, mais aussi la stabilité globale des sociétés. Il est essentiel de doter les jeunes des compétences nécessaires pour favoriser une culture de la paix, former des citoyens du monde responsables et promouvoir le développement durable afin de construire un avenir plus juste, plus inclusif et plus durable pour tous.
À l’occasion de la Journée mondiale des compétences des jeunes, unissons-nous pour reconnaître le potentiel des jeunes en tant qu’agents de paix et engageons-nous à leur donner les compétences et les opportunités nécessaires pour relever les défis et contribuer à un avenir pacifique, prospère et durable.
Source: Texte: https://www.un.org/fr/observances/ Image: PHOTO :UNESCO-UNEVOC/Rafael James Robea
Le saviez-vous ?
- Des estimations récentes suggèrent que 600 millions d’emplois devraient être créés au cours des 15 prochaines années pour répondre aux besoins d’emploi des jeunes.
- En 2021, environ 75 millions de jeunes étaient au chômage, 408 millions avaient un emploi et 732 millions étaient inactifs dans le monde.
- La part des jeunes qui ne sont ni en emploi, ni en éducation, ni en formation (NEET) en 2020 – la dernière année pour laquelle une estimation globale est disponible – a atteint 23,3 %, soit une augmentation de 1,5 % par rapport à l’année précédente et un niveau inégalé depuis au moins 15 ans.
- La population des jeunes augmentera de plus de 78 millions entre 2021 et 2030. Les pays à faible revenu représenteront près de la moitié de cette augmentation. Les systèmes d’éducation et de formation doivent répondre à ce défi.
- Au cours des deux dernières décennies, l’incidence du travail salarié chez les jeunes a augmenté de 15 %, contre 8 % chez les adultes.
- Des apprentissages de qualité, des stages bien conçus et des initiatives de volontariat peuvent constituer des points d’entrée sur le marché du travail pour les primo-demandeurs d’emploi et les jeunes diplômés.


 « La France a retenu la date du 27 janvier, jour anniversaire de la libération du camp d’Auschwitz, pour cette journée de la mémoire.
« La France a retenu la date du 27 janvier, jour anniversaire de la libération du camp d’Auschwitz, pour cette journée de la mémoire.
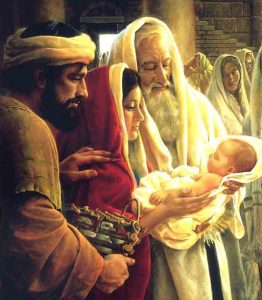 Le texte de l’évangile de cette fête nous offre la scène de la Présentation de Jésus au Temple (Luc 2:22-40).
Le texte de l’évangile de cette fête nous offre la scène de la Présentation de Jésus au Temple (Luc 2:22-40).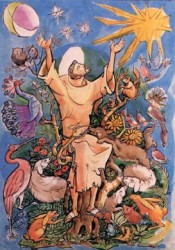 C’est le Pape François qui a pris l’initiative, dans son message du 6 août 2015, d’instituer cette journée mondiale, dans la droite ligne de sa récente encyclique Laudato Sì.
C’est le Pape François qui a pris l’initiative, dans son message du 6 août 2015, d’instituer cette journée mondiale, dans la droite ligne de sa récente encyclique Laudato Sì.